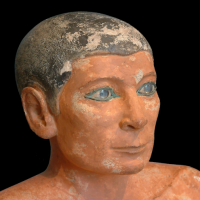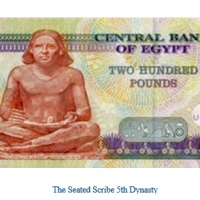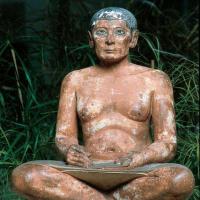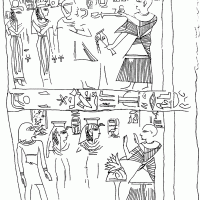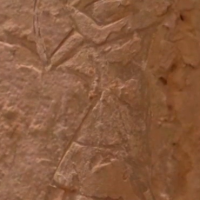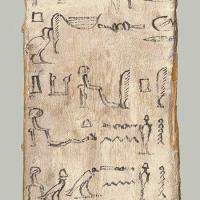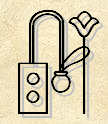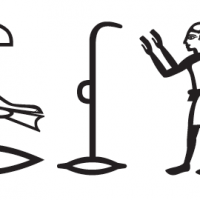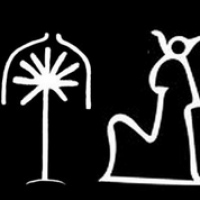LE NOMBRE PI - CONNU ET MAITRISÉ PAR LES ANCIENS ÉGYPTIENS - CONFÉRENCE DE QUENTIN LEPLAT - ARTEFACT
Malgré des réticences persistantes dans certains cercles académiques, un nombre croissant d’égyptologues, de mathématiciens et de chercheurs considèrent avec sérieux l’hypothèse selon laquelle le nombre aurait été intégré intentionnellement dans les proportions de la Grande Pyramide. Cette étude s’attache à montrer que les anciens Égyptiens utilisaient plusieurs fractions approchées de , en particulier les valeurs 22/7, 25/8, et la fraction moins connue 63/20.
L’usage simultané de ces approximations implique le recours à plusieurs longueurs de coudées, notamment :
52,38 cm pour la fraction 22/7,
52,5 cm pour la fraction 63/20.
Ces variations s’expliquent par des choix méthodologiques visant à obtenir des rapports géométriques cohérents avec les valeurs approchées de .
Dans les rares textes mathématiques égyptiens qui nous sont parvenus (notamment les papyrus de Rhind et de Moscou), l’utilisation d’un cercle de diamètre 9 unités permet une double cohérence : elle concilie à la fois les fractions 22/7 et 63/20, tout en conservant des valeurs entières pour le diamètre et le périmètre. Contrairement à une interprétation répandue selon laquelle les Égyptiens cherchaient uniquement à comparer la surface d’un carré de 8 unités à celle d’un cercle de diamètre 9, il semble que le choix du chiffre 9 soit motivé par des considérations pratiques et mathématiques, témoignant d’une compréhension opératoire remarquable de .
D’un point de vue symbolique, le chiffre 9 n’est pas anodin dans le corpus égyptien : il évoque immédiatement les neuf divinités de l’Ennéade, considérées comme les fondateurs de l’univers dans la cosmogonie d’Héliopolis. L’usage d’un cercle de 9 coudées s’inscrirait donc à la fois dans une logique mathématique et mythologique.
Ce schéma géométrique révèle en outre une clé astronomique que les anciens Égyptiens auraient pu intégrer de manière discrète, et qui serait restée largement inaperçue jusqu’à présent.
Enfin, une évaluation probabiliste de la récurrence du nombre dans les dimensions de la Grande Pyramide tend à exclure le simple hasard. Ces observations suggèrent une intentionnalité architecturale forte. L’introduction de dans l’architecture égyptienne semble ainsi répondre à plusieurs finalités, symbolique, par son lien avec les rituels d’encerclement protecteur ; et scientifique, par une volonté manifeste d’appliquer une connaissance d’apparence empirique du rapport entre la circonférence et le diamètre. "